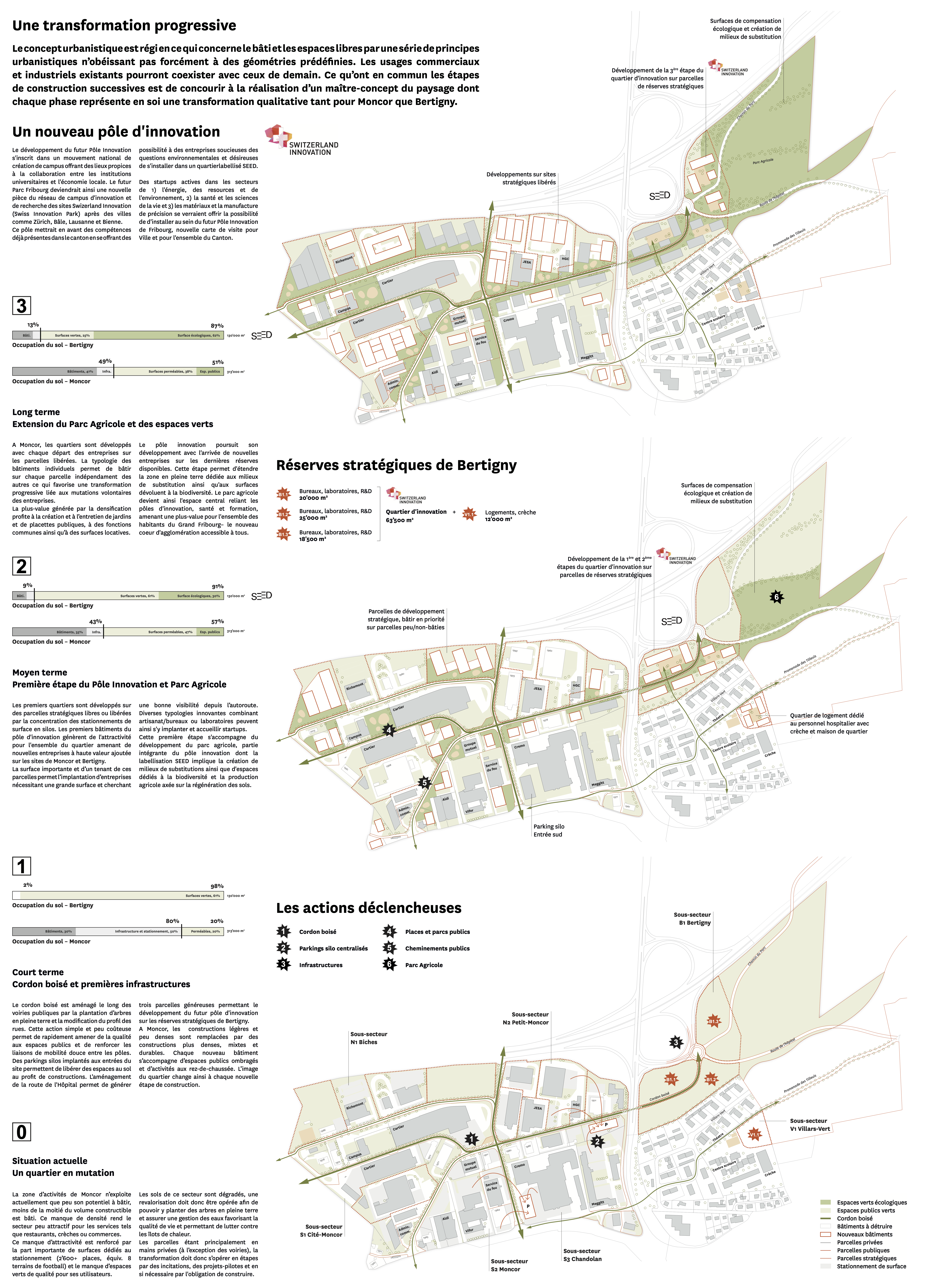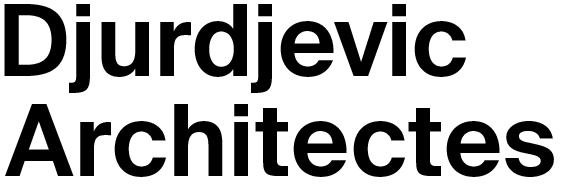014 Pôle Santé et Activités, Fribourg
Type de mandat: Mandat d‘étude parallèles, en procédure sélective
Maître d’ouvrage: Etat de Fribourg, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME)
Période de l’étude: 2023–24
Surface bâtie Hôpital 150’000 m2, campus universitaire 20’000 m2, zone d’activités 530’000 m2
Périmètre du projet: 1’200’000 m2 (120 ha)
Programmes: Hôpital de soins aigus (HFR), artisanat et industrie, services, éducation, parking, commerces
Urbanisme (pilote): Djurdjevic Architectes, Lausanne
Muriz Djurdjevic (chef de projet)
Architecture: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Wiktor Kacprzak, Béla Steiner
Architecture: IB+, Lausanne
Marwen Feriani, Georgia Malapani
Paysagisme: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco, Ludovic Heimo
Durabilité: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz, Juliette Vincent
Durabilité: GXN Innovation, Copenhague
Mattia di Carlo, Carolina Felix
Mobilité: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer
Images: Ferala, Bâle
RESILIO: une stratégie d’équilibre, de résilience et d’innovation
Le projet RESILIO incarne une vision stratégique à long terme, ancrée dans la résilience face aux incertitudes et la flexibilité nécessaire à un monde en perpétuelle évolution. Il s’agit de l’approche la plus robuste et la moins risquée, répondant pleinement au cahier des charges tout en préservant les marges d’adaptation. Cette posture garantit plusieurs niveaux de réussite, y compris en cas d’implémentation partielle, et assure la pérennité des choix initiaux.
Sobriété: faire avec l’existant.
RESILIO privilégie le "déjà-là", limitant ainsi les coûts tant économiques qu’écologiques. Plutôt que d’artificialiser massivement, le projet propose un développement progressif et réversible, permettant une réévaluation continue des besoins. Il assure un fonctionnement optimal même à petite échelle, sans bloquer l’évolution future du site.
Résilience: territoriale et planificatrice.
Nous intégrons une double résilience : territoriale, par la préservation des sols fertiles, bien commun non renouvelable; stratégique, par une planification ouverte, concertée et peu consommatrice de ressources. L’urbanisme proposé limite l’artificialisation et favorise un processus participatif impliquant l’ensemble des parties prenantes. Cette démarche réduit significativement les risques de recours juridiques ou d’oppositions citoyennes.
Pour le Pôle Santé et le nouvel hôpital, l’implantation choisie maximise les avantages existants : disponibilité immédiate du terrain réseaux d’infrastructures déjà en place (eau, électricité, etc.) et connaissance précise du sol. Ces choix permettent de réduire les incertitudes, de gagner plusieurs années sur le calendrier et de limiter les coûts de réalisation.
Anticipation et adaptabilité
Le projet crée un cadre physique et juridique propice à l’accueil d’activités économiques alignées avec les politiques climatiques et régionales du canton. L’absence d’artificialisation massive conserve une grande capacité d’adaptationaux futurs besoins des entreprises, tout en assurant une réserve stratégique foncière pour la commune et le canton. Concernant l’hôpital, le phasage flexible et la possibilité d’ajuster la taille du bâtiment préservent les options de développement sur le long terme.
Innovation: un campus au coeur des synergies fribourgeoises.
RESILIO propose la création d’un campus d’innovation, catalyseur de rayonnement pour Villars-sur-Glâne et Fribourg à l’échelle nationale et internationale. Situé au carrefour stratégique des manufactures de Moncor, du Parc agricole agroécologique et du campus santé et recherche médicale,
ce campus serait conçu comme un écosystème de synergies industrielles, intégrant la clean-tech, la recherche appliquée et la production durable. Il deviendrait la porte d’entrée de Fribourg, positionnant Bertigny comme un centre d’excellence au service de l’économie de demain.
Concept paysager
Le projet repose sur deux principes fondateurs inspirés du territoire fribourgeois : le plot urbain et la campagne agricole. La végétation en constitue l’élément central, traversant l’ensemble de la zone, qu’elle soit bâtie ou cultivée. Elle donne naissance à un corridor biologique unificateur, tissant des liens écologiques et visuels entre les différents quartiers.
La disposition du nouvel hôpital est pensée pour marquer la skyline de Fribourg : un bâtiment emblématique, visible depuis les alentours, qui offrira aux patients des vues privilégiées sur les Alpes et le Jura. Au nord, l’Agri-Parc évoluera en champs agroforestiers, suivant une trame paysagère structurée par des haies et des lignes d’arbres (système keyline) implantées le long des courbes de niveau. Ces plantations auront une double fonction : créer un paysage nourricier et résilient, et fournir un complément fourrager en période de sécheresse.
Des jardins ouvriers, des promenades, ainsi que divers usages pédagogiques et récréatifs viendront animer cet espace afin de le rendre accessible et appropriable par tous. L’Agri-Parc se structure selon une trame modulable, à différentes échelles de mailles, permettant de définir des lots adaptés aux besoins de ses usagers: individus (jardins potagers), associations (micro-fermes) et professionnels (maraîchage ou carrés bocagers).
La continuité végétale et la préservation de la canopée locale renforcent l’intégration écologique de l’ensemble et le maillage entre les parcelles cultivées. La pérennité du lieu repose sur l’expérience collective qui s’y développera. L’Agri-Parc sera encadré par une frange urbaine hybride, mi-construite, mi-végétale, assurant une transition douce et constructive avec la ville. Cette frange accueillera la ferme institutionnelle, des activités sociales et économiques dans des constructions légères, pensées pour favoriser la vie de quartier. Véritable interface entre la ville et la nature, elle formera une peau vivante entre l’urbain et le parc.
Gestion des sols
Malgré les connaissances déjà acquises sur l'importance des sols, le mitage des sols est très fort en Suisse, 1 m2 disparaît chaque seconde. Depuis 1933, 50 ha ont été imperméabilisés dans notre zone de réflexion. Nous considérons le sol agricole comme une ressource non renouvelable, ce qui est aussi la position de la Confédération, comme décrite dans la Stratégie des Sols de l’OFEV. De plus, 59 % de la vie sur terre se trouve dans les sols.
C’est pourquoi densifier ce qui est possible dans les zones déjà urbanisées et garder le plus de sol perméable sont pour nous une priorité. Cette stratégie, suivant le principe de Densification vers l'intérieur, nous l’utilisons pour le quartier de Moncor ainsi que pour le nouvel hôpital de Fribourg et son Pôle Santé. Le projet vise à préserver la terre au maximum en visant le zéro artificialisation nette, mais surtout à l’agrader, c’est-à-dire augmenter la quantité de vie qui y prend place : par des plantations d’arbres, des zones d’infiltration d’eau, et des pratiques d’entretien différenciées et d’exploitation agricole qui favorisent la vie du sol et intensifient ainsi le vivant.
La gestion des jardins familiaux et collectifs se fera par la ferme institutionnelle, qui pourra mettre en place les règles nécessaires à la préservation des sols, afin que la pollution, la compaction et l’érosion soient réduites au maximum et que le sol devienne un sol vivant. À cette fin, des formations devront être mises en place afin que les utilisateurs comprennent l’impact qu’ils ont sur le sol, la vie qu’il contient et la résilience qu'il procure.
Gestion des eaux
Au niveau du territoire, les agriculteurs sont encouragés à préserver le sol en évitant la compaction et en adoptant des pratiques agricoles biologiques, notamment en agroforesterie. L'aménagement de noues arborisées (Keyline) parallèles aux courbes du terrain vise à améliorer l’infiltration des eaux dans le sol et à réduire l'érosion de ces derniers. En effet, le sol est la plus grande réserve d'eau à disposition, mais à condition qu'il soit vivant et en bonne santé.
À l'échelle urbaine, le concept de la "ville éponge" cherche à atténuer les impacts des pluies intenses en maximisant les surfaces de sol perméable et en favorisant l'infiltration de l'eau. Divers outils, tels que la récupération des eaux de pluie en toiture (toiture végétalisée), des réservoirs enterrés et à ciel ouvert, des chaussées réservoirs, des tranchées de rétention, des noues/fossés plantés, et les jardins de pluie, sont préconisés pour prévenir les débordements et les inondations. L’eau stockée et la végétation vont ainsi permettre de drastiquement réduire les îlots de chaleur en été.
À l'échelle du bâtiment, les eaux grises, après traitement au charbon actif, peuvent être réutilisées pour les toilettes ou l'arrosage, offrant une économie significative d'eau. La séparation des urines et des fèces est demandée car cela contribue à la limitation de la pollution des eaux et ainsi limite l'augmentation des coûts de traitement des micropolluants dans les STEP. Ceci est particulièrement vrai pour l'hôpital, dont les urines des patients sont une source majeure de micropolluants. La valorisation de l'urine sur place, dès qu'un bâtiment atteint les 500 utilisateurs, doit être rendue obligatoire, permettant une production importante d'engrais local et décarboné (Blue Factory).
Maintien des sols fertils et arables
Une analyse pédologique approfondie du périmètre incluant les jardins familiaux, la micro-ferme de Bertigny et le futur Parc Agricole a permis d’identifier les zones les plus favorables au développement racinaire des plantes. Cette étude constitue une opportunité unique d’intégrer, dans le cadre du développement urbain, des mesures concrètes d’amélioration de la qualité des sols, notamment dans les secteurs actuellement dégradés.
Des différences marquées de profondeur utile des sols ont été mises en évidence sur l’ensemble du site. Au nord de l’autoroute, la profondeur moyenne du sol est d’environ 30 cm, correspondant à un sol reconstitué sur un remblai autoroutier. En revanche, au sud, cette profondeur varie entre 70 cm et 1 mètre, révélant une bien meilleure capacité d’enracinement.
Le secteur le plus propice à la plantation d’arbres de grande taille se situe au cœur du Parc Agricole, où les sols sont les plus profonds. À l’inverse, la zone située entre le quartier de Villars-Vert et l’entrée/sortie d’autoroute, plus proche des infrastructures, présente des sols peu profonds. Cette dernière a donc été réservée prioritairement au développement d’infrastructures et de bâti, dans le cadre des zones de réserve stratégique.
Une stratégie de revalorisation des sols est prévue, notamment à travers la récupération et le repositionnement des horizons pédologiques A, B et C issus des terres d’excavation. Cette approche permettra d’améliorer les sols appauvris, notamment dans les zones nord et le long de l’autoroute.
Parallèlement, les sols les plus fertiles du Parc Agricole seront valorisés et bonifiés progressivement. Divers milieux de substitution seront créés pour accroître le carbone organique des sols (COS) et favoriser la biodiversité : prairies permanentes non piétinables, zones humides et surfaces boisées remplaceront partiellement les terres actuellement cultivées de manière intensive.
Cette transformation contribuera à augmenter la capacité de séquestration du CO₂ et de rétention d’eau des sols, tout en assurant leur résilience à long terme. Couplée à des pratiques agricoles durables, elle favorisera la conservation et l’accumulation de stocks de carbone organique dans les sols arables.
Type de mandat: Mandat d‘étude parallèles, en procédure sélective
Maître d’ouvrage: Etat de Fribourg, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME)
Période de l’étude: 2023–24
Surface bâtie Hôpital 150’000 m2, campus universitaire 20’000 m2, zone d’activités 530’000 m2
Périmètre du projet: 1’200’000 m2 (120 ha)
Programmes: Hôpital de soins aigus (HFR), artisanat et industrie, services, éducation, parking, commerces
Urbanisme (pilote): Djurdjevic Architectes, Lausanne
Muriz Djurdjevic (chef de projet)
Architecture: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Wiktor Kacprzak, Béla Steiner
Architecture: IB+, Lausanne
Marwen Feriani, Georgia Malapani
Paysagisme: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco, Ludovic Heimo
Durabilité: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz, Juliette Vincent
Durabilité: GXN Innovation, Copenhague
Mattia di Carlo, Carolina Felix
Mobilité: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer
Images: Ferala, Bâle
RESILIO: une stratégie d’équilibre, de résilience et d’innovation
Le projet RESILIO incarne une vision stratégique à long terme, ancrée dans la résilience face aux incertitudes et la flexibilité nécessaire à un monde en perpétuelle évolution. Il s’agit de l’approche la plus robuste et la moins risquée, répondant pleinement au cahier des charges tout en préservant les marges d’adaptation. Cette posture garantit plusieurs niveaux de réussite, y compris en cas d’implémentation partielle, et assure la pérennité des choix initiaux.
Sobriété: faire avec l’existant.
RESILIO privilégie le "déjà-là", limitant ainsi les coûts tant économiques qu’écologiques. Plutôt que d’artificialiser massivement, le projet propose un développement progressif et réversible, permettant une réévaluation continue des besoins. Il assure un fonctionnement optimal même à petite échelle, sans bloquer l’évolution future du site.
Résilience: territoriale et planificatrice.
Nous intégrons une double résilience : territoriale, par la préservation des sols fertiles, bien commun non renouvelable; stratégique, par une planification ouverte, concertée et peu consommatrice de ressources. L’urbanisme proposé limite l’artificialisation et favorise un processus participatif impliquant l’ensemble des parties prenantes. Cette démarche réduit significativement les risques de recours juridiques ou d’oppositions citoyennes.
Pour le Pôle Santé et le nouvel hôpital, l’implantation choisie maximise les avantages existants : disponibilité immédiate du terrain réseaux d’infrastructures déjà en place (eau, électricité, etc.) et connaissance précise du sol. Ces choix permettent de réduire les incertitudes, de gagner plusieurs années sur le calendrier et de limiter les coûts de réalisation.
Anticipation et adaptabilité
Le projet crée un cadre physique et juridique propice à l’accueil d’activités économiques alignées avec les politiques climatiques et régionales du canton. L’absence d’artificialisation massive conserve une grande capacité d’adaptationaux futurs besoins des entreprises, tout en assurant une réserve stratégique foncière pour la commune et le canton. Concernant l’hôpital, le phasage flexible et la possibilité d’ajuster la taille du bâtiment préservent les options de développement sur le long terme.
Innovation: un campus au coeur des synergies fribourgeoises.
RESILIO propose la création d’un campus d’innovation, catalyseur de rayonnement pour Villars-sur-Glâne et Fribourg à l’échelle nationale et internationale. Situé au carrefour stratégique des manufactures de Moncor, du Parc agricole agroécologique et du campus santé et recherche médicale,
ce campus serait conçu comme un écosystème de synergies industrielles, intégrant la clean-tech, la recherche appliquée et la production durable. Il deviendrait la porte d’entrée de Fribourg, positionnant Bertigny comme un centre d’excellence au service de l’économie de demain.
Concept paysager
Le projet repose sur deux principes fondateurs inspirés du territoire fribourgeois : le plot urbain et la campagne agricole. La végétation en constitue l’élément central, traversant l’ensemble de la zone, qu’elle soit bâtie ou cultivée. Elle donne naissance à un corridor biologique unificateur, tissant des liens écologiques et visuels entre les différents quartiers.
La disposition du nouvel hôpital est pensée pour marquer la skyline de Fribourg : un bâtiment emblématique, visible depuis les alentours, qui offrira aux patients des vues privilégiées sur les Alpes et le Jura. Au nord, l’Agri-Parc évoluera en champs agroforestiers, suivant une trame paysagère structurée par des haies et des lignes d’arbres (système keyline) implantées le long des courbes de niveau. Ces plantations auront une double fonction : créer un paysage nourricier et résilient, et fournir un complément fourrager en période de sécheresse.
Des jardins ouvriers, des promenades, ainsi que divers usages pédagogiques et récréatifs viendront animer cet espace afin de le rendre accessible et appropriable par tous. L’Agri-Parc se structure selon une trame modulable, à différentes échelles de mailles, permettant de définir des lots adaptés aux besoins de ses usagers: individus (jardins potagers), associations (micro-fermes) et professionnels (maraîchage ou carrés bocagers).
La continuité végétale et la préservation de la canopée locale renforcent l’intégration écologique de l’ensemble et le maillage entre les parcelles cultivées. La pérennité du lieu repose sur l’expérience collective qui s’y développera. L’Agri-Parc sera encadré par une frange urbaine hybride, mi-construite, mi-végétale, assurant une transition douce et constructive avec la ville. Cette frange accueillera la ferme institutionnelle, des activités sociales et économiques dans des constructions légères, pensées pour favoriser la vie de quartier. Véritable interface entre la ville et la nature, elle formera une peau vivante entre l’urbain et le parc.
Gestion des sols
Malgré les connaissances déjà acquises sur l'importance des sols, le mitage des sols est très fort en Suisse, 1 m2 disparaît chaque seconde. Depuis 1933, 50 ha ont été imperméabilisés dans notre zone de réflexion. Nous considérons le sol agricole comme une ressource non renouvelable, ce qui est aussi la position de la Confédération, comme décrite dans la Stratégie des Sols de l’OFEV. De plus, 59 % de la vie sur terre se trouve dans les sols.
C’est pourquoi densifier ce qui est possible dans les zones déjà urbanisées et garder le plus de sol perméable sont pour nous une priorité. Cette stratégie, suivant le principe de Densification vers l'intérieur, nous l’utilisons pour le quartier de Moncor ainsi que pour le nouvel hôpital de Fribourg et son Pôle Santé. Le projet vise à préserver la terre au maximum en visant le zéro artificialisation nette, mais surtout à l’agrader, c’est-à-dire augmenter la quantité de vie qui y prend place : par des plantations d’arbres, des zones d’infiltration d’eau, et des pratiques d’entretien différenciées et d’exploitation agricole qui favorisent la vie du sol et intensifient ainsi le vivant.
La gestion des jardins familiaux et collectifs se fera par la ferme institutionnelle, qui pourra mettre en place les règles nécessaires à la préservation des sols, afin que la pollution, la compaction et l’érosion soient réduites au maximum et que le sol devienne un sol vivant. À cette fin, des formations devront être mises en place afin que les utilisateurs comprennent l’impact qu’ils ont sur le sol, la vie qu’il contient et la résilience qu'il procure.
Gestion des eaux
Au niveau du territoire, les agriculteurs sont encouragés à préserver le sol en évitant la compaction et en adoptant des pratiques agricoles biologiques, notamment en agroforesterie. L'aménagement de noues arborisées (Keyline) parallèles aux courbes du terrain vise à améliorer l’infiltration des eaux dans le sol et à réduire l'érosion de ces derniers. En effet, le sol est la plus grande réserve d'eau à disposition, mais à condition qu'il soit vivant et en bonne santé.
À l'échelle urbaine, le concept de la "ville éponge" cherche à atténuer les impacts des pluies intenses en maximisant les surfaces de sol perméable et en favorisant l'infiltration de l'eau. Divers outils, tels que la récupération des eaux de pluie en toiture (toiture végétalisée), des réservoirs enterrés et à ciel ouvert, des chaussées réservoirs, des tranchées de rétention, des noues/fossés plantés, et les jardins de pluie, sont préconisés pour prévenir les débordements et les inondations. L’eau stockée et la végétation vont ainsi permettre de drastiquement réduire les îlots de chaleur en été.
À l'échelle du bâtiment, les eaux grises, après traitement au charbon actif, peuvent être réutilisées pour les toilettes ou l'arrosage, offrant une économie significative d'eau. La séparation des urines et des fèces est demandée car cela contribue à la limitation de la pollution des eaux et ainsi limite l'augmentation des coûts de traitement des micropolluants dans les STEP. Ceci est particulièrement vrai pour l'hôpital, dont les urines des patients sont une source majeure de micropolluants. La valorisation de l'urine sur place, dès qu'un bâtiment atteint les 500 utilisateurs, doit être rendue obligatoire, permettant une production importante d'engrais local et décarboné (Blue Factory).
Maintien des sols fertils et arables
Une analyse pédologique approfondie du périmètre incluant les jardins familiaux, la micro-ferme de Bertigny et le futur Parc Agricole a permis d’identifier les zones les plus favorables au développement racinaire des plantes. Cette étude constitue une opportunité unique d’intégrer, dans le cadre du développement urbain, des mesures concrètes d’amélioration de la qualité des sols, notamment dans les secteurs actuellement dégradés.
Des différences marquées de profondeur utile des sols ont été mises en évidence sur l’ensemble du site. Au nord de l’autoroute, la profondeur moyenne du sol est d’environ 30 cm, correspondant à un sol reconstitué sur un remblai autoroutier. En revanche, au sud, cette profondeur varie entre 70 cm et 1 mètre, révélant une bien meilleure capacité d’enracinement.
Le secteur le plus propice à la plantation d’arbres de grande taille se situe au cœur du Parc Agricole, où les sols sont les plus profonds. À l’inverse, la zone située entre le quartier de Villars-Vert et l’entrée/sortie d’autoroute, plus proche des infrastructures, présente des sols peu profonds. Cette dernière a donc été réservée prioritairement au développement d’infrastructures et de bâti, dans le cadre des zones de réserve stratégique.
Une stratégie de revalorisation des sols est prévue, notamment à travers la récupération et le repositionnement des horizons pédologiques A, B et C issus des terres d’excavation. Cette approche permettra d’améliorer les sols appauvris, notamment dans les zones nord et le long de l’autoroute.
Parallèlement, les sols les plus fertiles du Parc Agricole seront valorisés et bonifiés progressivement. Divers milieux de substitution seront créés pour accroître le carbone organique des sols (COS) et favoriser la biodiversité : prairies permanentes non piétinables, zones humides et surfaces boisées remplaceront partiellement les terres actuellement cultivées de manière intensive.
Cette transformation contribuera à augmenter la capacité de séquestration du CO₂ et de rétention d’eau des sols, tout en assurant leur résilience à long terme. Couplée à des pratiques agricoles durables, elle favorisera la conservation et l’accumulation de stocks de carbone organique dans les sols arables.