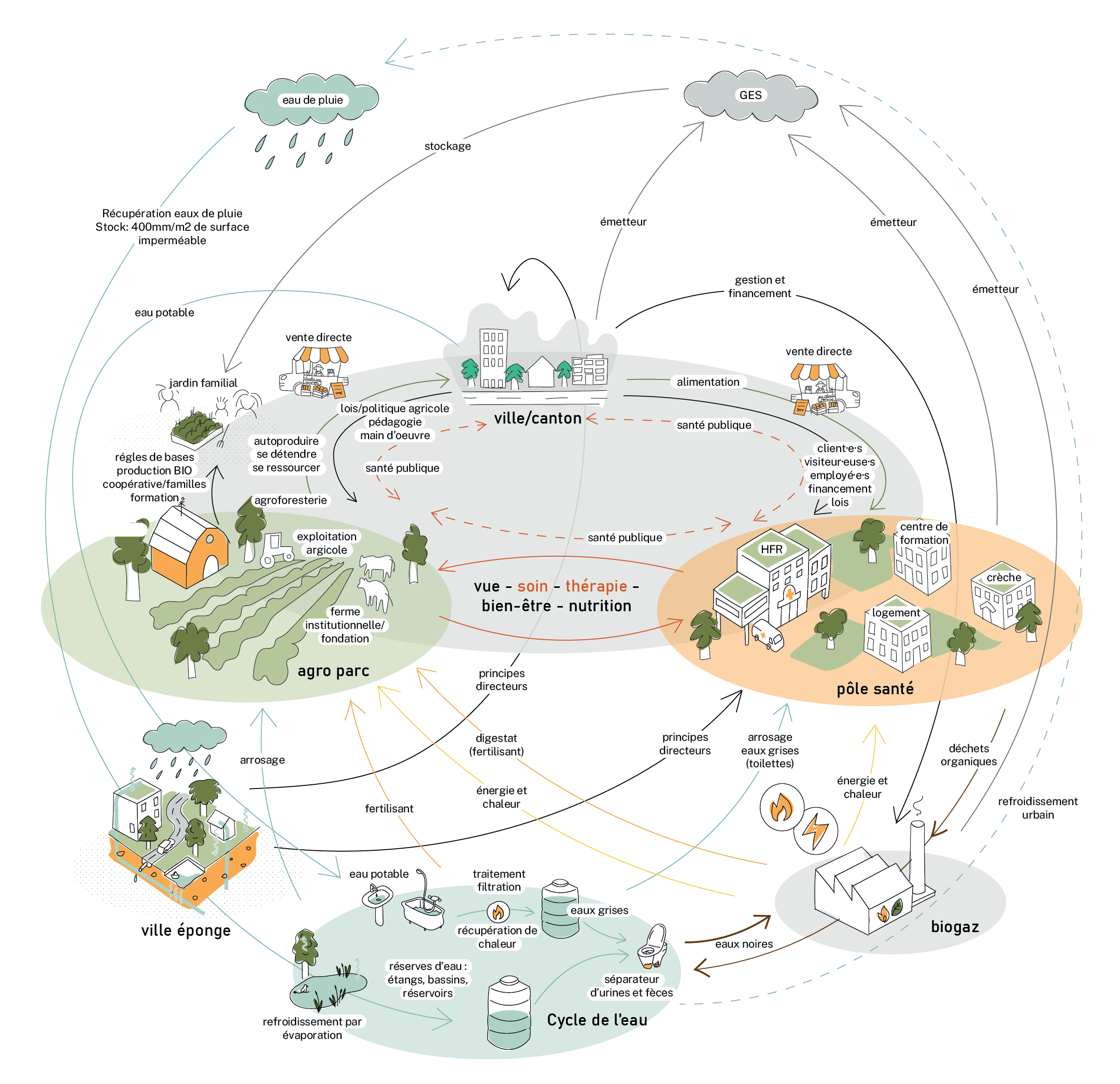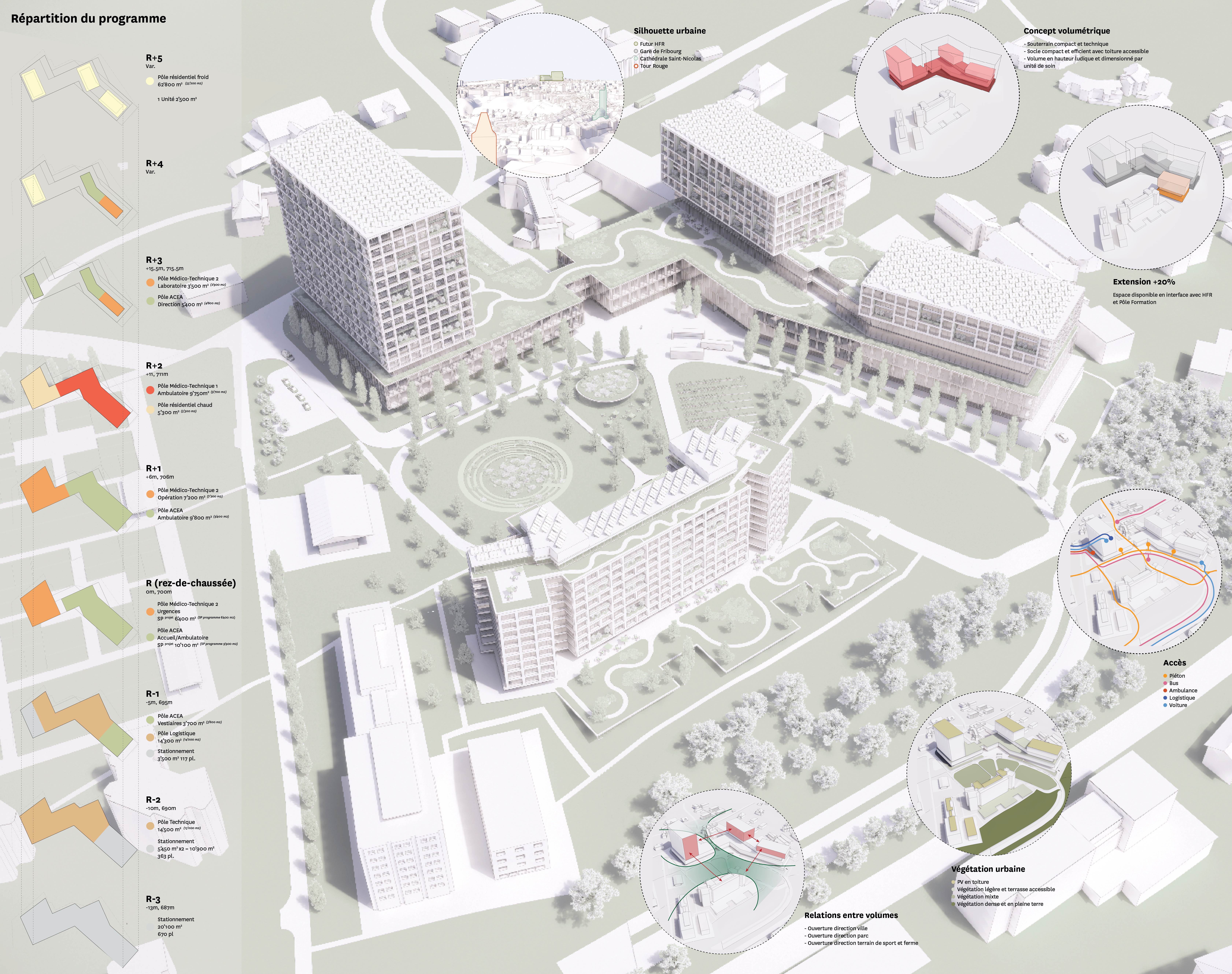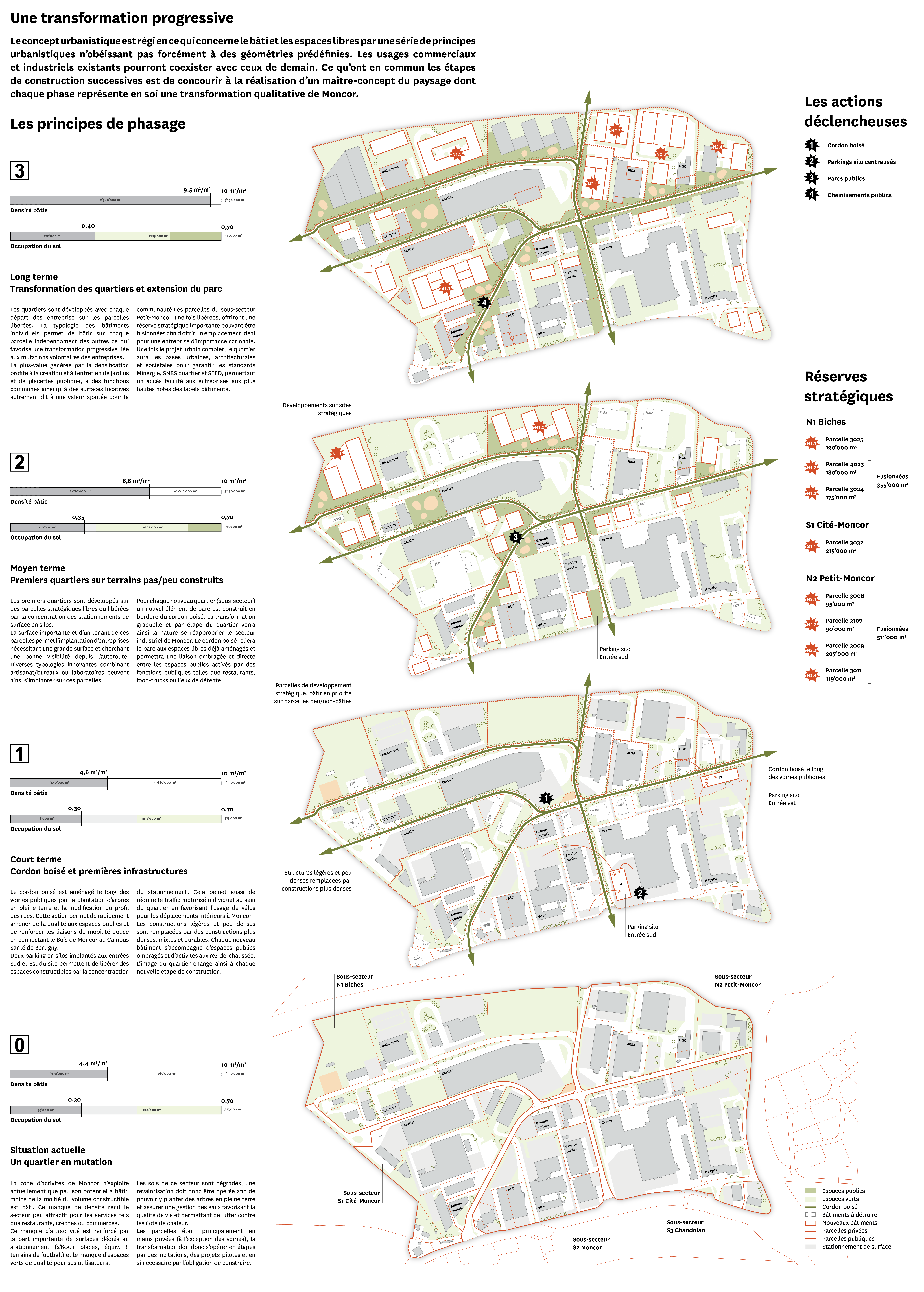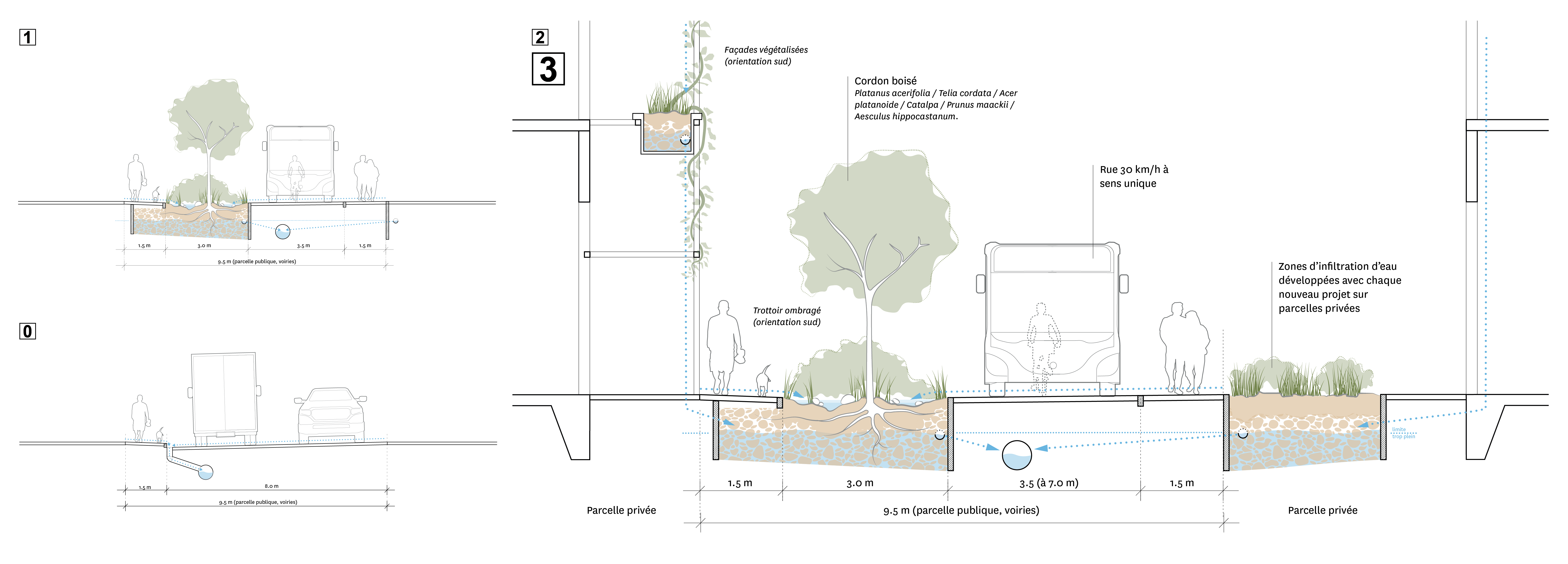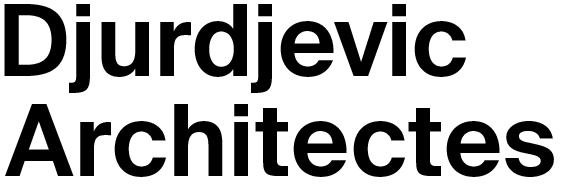014 Pôle Santé et Activités, Fribourg
Type de mandat: Mandat d‘étude parallèles, en procédure sélective
Maître d’ouvrage: Etat de Fribourg, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME)
Période de l’étude: 2023–24
Surface bâtie Hôpital 150’000 m2, campus universitaire 20’000 m2, zone d’activités 530’000 m2
Périmètre du projet: 1’200’000 m2 (120 ha)
Programmes: Hôpital de soins aigus (HFR), artisanat et industrie, services, éducation, parking, commerces
Urbanisme (pilote): Djurdjevic Architectes, Lausanne
Muriz Djurdjevic (chef de projet)
Architecture: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Julius Kai Lin
Architecture: IB+, Lausanne
Catherine Jaquier-Bühler, Marwen Feriani, Georgia Malapani
Paysagisme: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco
Durabilité: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz
Durabilité: GXN Innovation, Copenhague
Lasse Lind, Mattia di Carlo
Mobilité: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer, Marius Menthonnex
Images: 3XN/GXN, Copenhague
Resilio
Le projet RESILIO représente l'équilibre entre une vision à long terme, la résilience face aux incertitudes, et la flexibilité nécessaire pour s'adapter à un monde en constante évolution. C'est l'approche la moins risquée, car elle répond au cahier des charges tout en laissant les options ouvertes. Il garantit plusieurs niveaux de réussite et assure la pérennité de la vision stratégique, même en cas d'implémentation partielle.
Sobriété. Nous travaillons avec le "déjà là", garantissant ainsi le respect du cahier des charges à moindre coût économique et écologique. Plutôt que d'artificialiser la zone et de bloquer le développement dans une seule direction, notre projet permet une réévaluation constante des besoins et assure un fonctionnement optimal à une échelle plus restreinte.
Résilience. Nous proposons une résilience à la fois territoriale et dans la planification. En proposant un urbanisme attractif, sans artificialisation, élaboré par un processus participatif avec les différentes parties prenantes, nous réduisons le risque de recours des voisins et d'opposition d'associations environnementales. Pour le Pôle Santé et le nouvel hôpital l'emplacement proposé assure la disponibilité immédiate du site, la présence des raccordements aux réseaux nécessaires (eau, électricité, ...) et la connaissance du terrain à bâtir. Ce sont trois risques majeurs éliminés qui permettent de gagner plusieurs années sur la construction et qui limitent les coûts. Au niveau du territoire, notre axe majeur est la préservation des sols, car une fois détruits ou pollués, il n'y a pas de retour en arrière.
Anticipation & adaptabilité. Notre projet d'aménagement crée un environnement physique et légal propice aux entreprises alignées sur les politiques climatiques et économiques du canton. En évitant une artificialisation excessive, notre approche maintient la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins changeants des entreprises dans le futur, en garantissant une réserve pour le canton et la commune. Pour le projet de l'hôpital, la capacité à changer la taille et les affectations en cours de route garantit la préservation des options le plus longtemps possible. Le développement économique de la zone d'activité se doit d'être agile et adaptable en fonction des besoins futurs que l'on ne peut anticiper à ce stade. Lier la réalisation d'une infrastructure lourde telle qu'un hôpital avec cette dernière est une erreur stratégique. C'est pourquoi nous détachons la réalisation du nouvel hôpital du pôle économique.
Cadre légal et prospective
En octobre 2023, le canton de Fribourg a marqué une étape significative avec l’adoption de la Stratégie des sols. Axée sur la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et la résilience climatique, cette initiative vise à sauvegarder les sols de haute qualité et à préserver leur fonctionnalité écosystémique. En parallèle, le Plan climatique cantonal renforce l’engagement en faveur de la protection des sols et des eaux. Le projet que nous proposons s’inscrit parfaitement dans le cadre de ces plans cantonaux, et ainsi ne propose pas une vision mort-née qui s’inscrirait, avant même le premier coup de pioche de l’hôpital, contre toutes les dernières évolutions stratégiques cantonales.
Au niveau des entreprises, que le cahier des charges demande de prendre en compte, il faut absolument tenir compte de l’évolution du cadre normatif national et européen. Une hausse de la demande en label de construction est à prévoir pour le type d’entreprise que la zone d’activité cible. À l’échelle nationale, notamment suite à la votation du 18 juin 2023, "le peuple suisse a voté sur la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, (...)" il est à attendre un resserrement du cadre juridique en termes de durabilité et une obligation de reporter des critères non financiers pour des entreprises de taille moyenne à grande (les entreprises justement visées par le cahier des charges). À l’échelle européenne, l’entrée en vigueur de la Directive sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (CSR) en 2023 et les demandes de financements du Green Deal conditionnées à cela soulignent l’importance d’une transparence accrue et d’une obligation de publier un rapport RSE rigoureux. Les grandes entreprises seront obligées d’adopter des pratiques durables. Dans ce contexte, le choix du site pour l’implantation de leur nouveau site et la labellisation des constructions émergent comme des leviers essentiels. Facilement mis en place lors de la construction d’une nouvelle infrastructure et permettant une remontée facilitée des données auditées lors des rapports non financiers.
Notre projet, par son design, permet d’atteindre des labels de quartier tels que SEED, Minergie et SNBS. Cependant, il est crucial de noter que les plus hauts niveaux de labellisation suisse (Minergie et SNBS) et européen (DGNB) ne seront pas accessibles en cas d'artificialisation. Surtout dans le futur, car les labels vont sans cesse resserrer leurs exigences. La labellisation du quartier et de ses bâtiments facilitera l’implantation d’entreprises partageant les politiques locales et les objectifs cantonaux de durabilité, ceci garantira un standard élevé de construction. Par ailleurs, elle offrira aux start-ups et aux PME un cadre urbain et construit préétabli avec un niveau de RSE très élevé, devenant un argument d’attractivité pour les entreprises partageant ces valeurs.
Cycles physico-chimique
Nous traitons le territoire comme une ressource finie, et notre travail propose une approche de résilience par la biodiversité et la valorisation des services écosystémiques. Traitant le territoire comme un être vivant dont toutes les parties doivent être pensées pour garantir l'atténuation par l'adaptation des espaces publics et du paysage, nous mettons en place des écosystèmes à l'échelle du quartier et de la ville. Ces relations profitables entre notre espèce et son environnement ne sont possibles que par l'interaction avec et par le vivant. Le sol en est l'acteur majeur, abritant 25% de la biomasse terrestre. Un sol vivant retient et filtre l'eau, permet la culture et façonne le terroir. Sans sol vivant, pas d'adaptation au dérèglement climatique. La nature permet aussi de nous soigner. Les thérapies impliquant des animaux ou la prise en charge de plantes sont reconnues pour leurs effets positifs sur les problèmes psychologiques, neuro-psychologiques et moteurs. L'implantation du pôle santé en bordure de l'Agri-Parc et directement liée à la ferme institutionnelle permet cette proximité entre le malade et la nature.
Concept paysager
Le projet repose sur deux principes fribourgeois, le plot urbain et la campagne agricole. La végétation est l'élément central qui vient se mêler à toute la zone, qu'elle soit agricole ou urbaine. Elle propose un corridor biologique commun qui va unir les différents quartiers entre eux. La disposition choisie pour le nouvel hôpital vient marquer la skyline de Fribourg par un bâtiment emblématique visible de loin, qui donnera lui-même un accès privilégié aux patients avec des vues en direction des Alpes et du Jura. Le paysage de la zone va changer. Au sud, un quartier industriel peu dense va se transformer en quartier durable mixte mêlant artisanat, industries et services favorisant la mobilité douce et la rencontre, où les îlots de chaleur n'existeront plus grâce à une végétalisation des espaces.
La partie Nord, l'Agri-Parc, se transformera en champs agroforestiers, avec haies et lignées d'arbres (keyline) qui longeront les courbes de niveaux. De plus, ces arbres serviront de source fourragère ou nourricière pour pallier au manque de fourrage pendant les périodes de sécheresse. Les jardins ouvriers, les promenades et les diverses fonctions ont pour but de faire connaître cet espace. La protection et la pérennité du lieu viennent de l'expérience partagée de l'endroit. Ce parc sera délimité par une frange urbaine mi-construite mi-végétale qui pérennisera constructivement l'Agri-Parc. Cette frange accueillera les bâtiments de la ferme institutionnelle, des activités sociales et économiques dans des constructions légères favorisant la vie de quartier. Elle agira comme une peau entre la ville et le parc.
Gestion des sols
Malgré les connaissances déjà acquises sur l'importance des sols, le mitage des sols est très fort en Suisse, 1 m2 disparaît chaque seconde. Depuis 1933, 50 ha ont été imperméabilisés dans notre zone de réflexion. Nous considérons le sol agricole comme une ressource non renouvelable, ce qui est aussi la position de la Confédération, comme décrite dans la Stratégie des Sols de l’OFEV. De plus, 59 % de la vie sur terre se trouve dans les sols.
C’est pourquoi densifier ce qui est possible dans les zones déjà urbanisées et garder le plus de sol perméable sont pour nous une priorité. Cette stratégie, suivant le principe de Densification vers l'intérieur, nous l’utilisons pour le quartier de Moncor ainsi que pour le nouvel hôpital de Fribourg et son Pôle Santé. Le projet vise à préserver la terre au maximum en visant le zéro artificialisation nette, mais surtout à l’agrader, c’est-à-dire augmenter la quantité de vie qui y prend place : par des plantations d’arbres, des zones d’infiltration d’eau, et des pratiques d’entretien différenciées et d’exploitation agricole qui favorisent la vie du sol et intensifient ainsi le vivant.
La gestion des jardins familiaux et collectifs se fera par la ferme institutionnelle, qui pourra mettre en place les règles nécessaires à la préservation des sols, afin que la pollution, la compaction et l’érosion soient réduites au maximum et que le sol devienne un sol vivant. À cette fin, des formations devront être mises en place afin que les utilisateurs comprennent l’impact qu’ils ont sur le sol, la vie qu’il contient et la résilience qu'il procure.
Gestion des eaux
Au niveau du territoire, les agriculteurs sont encouragés à préserver le sol en évitant la compaction et en adoptant des pratiques agricoles biologiques, notamment en agroforesterie. L'aménagement de noues arborisées (Keyline) parallèles aux courbes du terrain vise à améliorer l’infiltration des eaux dans le sol et à réduire l'érosion de ces derniers. En effet, le sol est la plus grande réserve d'eau à disposition, mais à condition qu'il soit vivant et en bonne santé.
À l'échelle urbaine, le concept de la "ville éponge" cherche à atténuer les impacts des pluies intenses en maximisant les surfaces de sol perméable et en favorisant l'infiltration de l'eau. Divers outils, tels que la récupération des eaux de pluie en toiture (toiture végétalisée), des réservoirs enterrés et à ciel ouvert, des chaussées réservoirs, des tranchées de rétention, des noues/fossés plantés, et les jardins de pluie, sont préconisés pour prévenir les débordements et les inondations. L’eau stockée et la végétation vont ainsi permettre de drastiquement réduire les îlots de chaleur en été.
À l'échelle du bâtiment, les eaux grises, après traitement au charbon actif, peuvent être réutilisées pour les toilettes ou l'arrosage, offrant une économie significative d'eau. La séparation des urines et des fèces est demandée car cela contribue à la limitation de la pollution des eaux et ainsi limite l'augmentation des coûts de traitement des micropolluants dans les STEP. Ceci est particulièrement vrai pour l'hôpital, dont les urines des patients sont une source majeure de micropolluants. La valorisation de l'urine sur place, dès qu'un bâtiment atteint les 500 utilisateurs, doit être rendue obligatoire, permettant une production importante d'engrais local et décarboné (Blue Factory).
Type de mandat: Mandat d‘étude parallèles, en procédure sélective
Maître d’ouvrage: Etat de Fribourg, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME)
Période de l’étude: 2023–24
Surface bâtie Hôpital 150’000 m2, campus universitaire 20’000 m2, zone d’activités 530’000 m2
Périmètre du projet: 1’200’000 m2 (120 ha)
Programmes: Hôpital de soins aigus (HFR), artisanat et industrie, services, éducation, parking, commerces
Urbanisme (pilote): Djurdjevic Architectes, Lausanne
Muriz Djurdjevic (chef de projet)
Architecture: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Julius Kai Lin
Architecture: IB+, Lausanne
Catherine Jaquier-Bühler, Marwen Feriani, Georgia Malapani
Paysagisme: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco
Durabilité: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz
Durabilité: GXN Innovation, Copenhague
Lasse Lind, Mattia di Carlo
Mobilité: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer, Marius Menthonnex
Images: 3XN/GXN, Copenhague
Resilio
Le projet RESILIO représente l'équilibre entre une vision à long terme, la résilience face aux incertitudes, et la flexibilité nécessaire pour s'adapter à un monde en constante évolution. C'est l'approche la moins risquée, car elle répond au cahier des charges tout en laissant les options ouvertes. Il garantit plusieurs niveaux de réussite et assure la pérennité de la vision stratégique, même en cas d'implémentation partielle.
Sobriété. Nous travaillons avec le "déjà là", garantissant ainsi le respect du cahier des charges à moindre coût économique et écologique. Plutôt que d'artificialiser la zone et de bloquer le développement dans une seule direction, notre projet permet une réévaluation constante des besoins et assure un fonctionnement optimal à une échelle plus restreinte.
Résilience. Nous proposons une résilience à la fois territoriale et dans la planification. En proposant un urbanisme attractif, sans artificialisation, élaboré par un processus participatif avec les différentes parties prenantes, nous réduisons le risque de recours des voisins et d'opposition d'associations environnementales. Pour le Pôle Santé et le nouvel hôpital l'emplacement proposé assure la disponibilité immédiate du site, la présence des raccordements aux réseaux nécessaires (eau, électricité, ...) et la connaissance du terrain à bâtir. Ce sont trois risques majeurs éliminés qui permettent de gagner plusieurs années sur la construction et qui limitent les coûts. Au niveau du territoire, notre axe majeur est la préservation des sols, car une fois détruits ou pollués, il n'y a pas de retour en arrière.
Anticipation & adaptabilité. Notre projet d'aménagement crée un environnement physique et légal propice aux entreprises alignées sur les politiques climatiques et économiques du canton. En évitant une artificialisation excessive, notre approche maintient la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins changeants des entreprises dans le futur, en garantissant une réserve pour le canton et la commune. Pour le projet de l'hôpital, la capacité à changer la taille et les affectations en cours de route garantit la préservation des options le plus longtemps possible. Le développement économique de la zone d'activité se doit d'être agile et adaptable en fonction des besoins futurs que l'on ne peut anticiper à ce stade. Lier la réalisation d'une infrastructure lourde telle qu'un hôpital avec cette dernière est une erreur stratégique. C'est pourquoi nous détachons la réalisation du nouvel hôpital du pôle économique.
Cadre légal et prospective
En octobre 2023, le canton de Fribourg a marqué une étape significative avec l’adoption de la Stratégie des sols. Axée sur la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et la résilience climatique, cette initiative vise à sauvegarder les sols de haute qualité et à préserver leur fonctionnalité écosystémique. En parallèle, le Plan climatique cantonal renforce l’engagement en faveur de la protection des sols et des eaux. Le projet que nous proposons s’inscrit parfaitement dans le cadre de ces plans cantonaux, et ainsi ne propose pas une vision mort-née qui s’inscrirait, avant même le premier coup de pioche de l’hôpital, contre toutes les dernières évolutions stratégiques cantonales.
Au niveau des entreprises, que le cahier des charges demande de prendre en compte, il faut absolument tenir compte de l’évolution du cadre normatif national et européen. Une hausse de la demande en label de construction est à prévoir pour le type d’entreprise que la zone d’activité cible. À l’échelle nationale, notamment suite à la votation du 18 juin 2023, "le peuple suisse a voté sur la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, (...)" il est à attendre un resserrement du cadre juridique en termes de durabilité et une obligation de reporter des critères non financiers pour des entreprises de taille moyenne à grande (les entreprises justement visées par le cahier des charges). À l’échelle européenne, l’entrée en vigueur de la Directive sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (CSR) en 2023 et les demandes de financements du Green Deal conditionnées à cela soulignent l’importance d’une transparence accrue et d’une obligation de publier un rapport RSE rigoureux. Les grandes entreprises seront obligées d’adopter des pratiques durables. Dans ce contexte, le choix du site pour l’implantation de leur nouveau site et la labellisation des constructions émergent comme des leviers essentiels. Facilement mis en place lors de la construction d’une nouvelle infrastructure et permettant une remontée facilitée des données auditées lors des rapports non financiers.
Notre projet, par son design, permet d’atteindre des labels de quartier tels que SEED, Minergie et SNBS. Cependant, il est crucial de noter que les plus hauts niveaux de labellisation suisse (Minergie et SNBS) et européen (DGNB) ne seront pas accessibles en cas d'artificialisation. Surtout dans le futur, car les labels vont sans cesse resserrer leurs exigences. La labellisation du quartier et de ses bâtiments facilitera l’implantation d’entreprises partageant les politiques locales et les objectifs cantonaux de durabilité, ceci garantira un standard élevé de construction. Par ailleurs, elle offrira aux start-ups et aux PME un cadre urbain et construit préétabli avec un niveau de RSE très élevé, devenant un argument d’attractivité pour les entreprises partageant ces valeurs.
Cycles physico-chimique
Nous traitons le territoire comme une ressource finie, et notre travail propose une approche de résilience par la biodiversité et la valorisation des services écosystémiques. Traitant le territoire comme un être vivant dont toutes les parties doivent être pensées pour garantir l'atténuation par l'adaptation des espaces publics et du paysage, nous mettons en place des écosystèmes à l'échelle du quartier et de la ville. Ces relations profitables entre notre espèce et son environnement ne sont possibles que par l'interaction avec et par le vivant. Le sol en est l'acteur majeur, abritant 25% de la biomasse terrestre. Un sol vivant retient et filtre l'eau, permet la culture et façonne le terroir. Sans sol vivant, pas d'adaptation au dérèglement climatique. La nature permet aussi de nous soigner. Les thérapies impliquant des animaux ou la prise en charge de plantes sont reconnues pour leurs effets positifs sur les problèmes psychologiques, neuro-psychologiques et moteurs. L'implantation du pôle santé en bordure de l'Agri-Parc et directement liée à la ferme institutionnelle permet cette proximité entre le malade et la nature.
Concept paysager
Le projet repose sur deux principes fribourgeois, le plot urbain et la campagne agricole. La végétation est l'élément central qui vient se mêler à toute la zone, qu'elle soit agricole ou urbaine. Elle propose un corridor biologique commun qui va unir les différents quartiers entre eux. La disposition choisie pour le nouvel hôpital vient marquer la skyline de Fribourg par un bâtiment emblématique visible de loin, qui donnera lui-même un accès privilégié aux patients avec des vues en direction des Alpes et du Jura. Le paysage de la zone va changer. Au sud, un quartier industriel peu dense va se transformer en quartier durable mixte mêlant artisanat, industries et services favorisant la mobilité douce et la rencontre, où les îlots de chaleur n'existeront plus grâce à une végétalisation des espaces.
La partie Nord, l'Agri-Parc, se transformera en champs agroforestiers, avec haies et lignées d'arbres (keyline) qui longeront les courbes de niveaux. De plus, ces arbres serviront de source fourragère ou nourricière pour pallier au manque de fourrage pendant les périodes de sécheresse. Les jardins ouvriers, les promenades et les diverses fonctions ont pour but de faire connaître cet espace. La protection et la pérennité du lieu viennent de l'expérience partagée de l'endroit. Ce parc sera délimité par une frange urbaine mi-construite mi-végétale qui pérennisera constructivement l'Agri-Parc. Cette frange accueillera les bâtiments de la ferme institutionnelle, des activités sociales et économiques dans des constructions légères favorisant la vie de quartier. Elle agira comme une peau entre la ville et le parc.
Gestion des sols
Malgré les connaissances déjà acquises sur l'importance des sols, le mitage des sols est très fort en Suisse, 1 m2 disparaît chaque seconde. Depuis 1933, 50 ha ont été imperméabilisés dans notre zone de réflexion. Nous considérons le sol agricole comme une ressource non renouvelable, ce qui est aussi la position de la Confédération, comme décrite dans la Stratégie des Sols de l’OFEV. De plus, 59 % de la vie sur terre se trouve dans les sols.
C’est pourquoi densifier ce qui est possible dans les zones déjà urbanisées et garder le plus de sol perméable sont pour nous une priorité. Cette stratégie, suivant le principe de Densification vers l'intérieur, nous l’utilisons pour le quartier de Moncor ainsi que pour le nouvel hôpital de Fribourg et son Pôle Santé. Le projet vise à préserver la terre au maximum en visant le zéro artificialisation nette, mais surtout à l’agrader, c’est-à-dire augmenter la quantité de vie qui y prend place : par des plantations d’arbres, des zones d’infiltration d’eau, et des pratiques d’entretien différenciées et d’exploitation agricole qui favorisent la vie du sol et intensifient ainsi le vivant.
La gestion des jardins familiaux et collectifs se fera par la ferme institutionnelle, qui pourra mettre en place les règles nécessaires à la préservation des sols, afin que la pollution, la compaction et l’érosion soient réduites au maximum et que le sol devienne un sol vivant. À cette fin, des formations devront être mises en place afin que les utilisateurs comprennent l’impact qu’ils ont sur le sol, la vie qu’il contient et la résilience qu'il procure.
Gestion des eaux
Au niveau du territoire, les agriculteurs sont encouragés à préserver le sol en évitant la compaction et en adoptant des pratiques agricoles biologiques, notamment en agroforesterie. L'aménagement de noues arborisées (Keyline) parallèles aux courbes du terrain vise à améliorer l’infiltration des eaux dans le sol et à réduire l'érosion de ces derniers. En effet, le sol est la plus grande réserve d'eau à disposition, mais à condition qu'il soit vivant et en bonne santé.
À l'échelle urbaine, le concept de la "ville éponge" cherche à atténuer les impacts des pluies intenses en maximisant les surfaces de sol perméable et en favorisant l'infiltration de l'eau. Divers outils, tels que la récupération des eaux de pluie en toiture (toiture végétalisée), des réservoirs enterrés et à ciel ouvert, des chaussées réservoirs, des tranchées de rétention, des noues/fossés plantés, et les jardins de pluie, sont préconisés pour prévenir les débordements et les inondations. L’eau stockée et la végétation vont ainsi permettre de drastiquement réduire les îlots de chaleur en été.
À l'échelle du bâtiment, les eaux grises, après traitement au charbon actif, peuvent être réutilisées pour les toilettes ou l'arrosage, offrant une économie significative d'eau. La séparation des urines et des fèces est demandée car cela contribue à la limitation de la pollution des eaux et ainsi limite l'augmentation des coûts de traitement des micropolluants dans les STEP. Ceci est particulièrement vrai pour l'hôpital, dont les urines des patients sont une source majeure de micropolluants. La valorisation de l'urine sur place, dès qu'un bâtiment atteint les 500 utilisateurs, doit être rendue obligatoire, permettant une production importante d'engrais local et décarboné (Blue Factory).